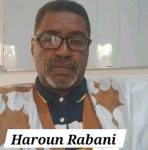 La Mauritanie traverse une phase critique où les fragilités du régime actuel s’entrecroisent avec les tensions internes, les bouleversements régionaux et les accusations extérieures croissantes. Si ces faiblesses ne sont pas corrigées rapidement, elles risquent de précipiter le pays dans une profonde instabilité. En dépit d’un discours officiel affichant des ambitions de réforme, le pouvoir peine à instaurer une véritable culture de transparence et de redevabilité : les nominations clientélistes, l’absence de sanction des abus et la faiblesse du contrôle parlementaire, d’une opposition crédible alimentent une méfiance généralisée qui affaiblit la crédibilité de l’État face à ses partenaires et réduit sa capacité à répondre aux critiques. Par ailleurs, la persistance de la pauvreté, l’insécurité urbaine grandissante, l’affluence continue des émigrés, le chômage massif des jeunes et l’injustice dans la répartition des ressources nourrissent un sentiment de marginalisation, tandis que le décalage entre les déclarations officielles et la réalité vécue par les citoyens mine la confiance envers les institutions et crée un terrain propice aux protestations ou à la radicalisation. Le régime n’a pas non plus su désamorcer les tensions ethniques et communautaires ni instaurer un dialogue politique inclusif, laissant les divisions internes se transformer en leviers d’instrumentalisation qui sapent la cohésion nationale et affaiblissent la résilience du pays face aux pressions extérieures. Dans le même temps, l’instabilité régionale au Sahel ; marquée par la progression des groupes armés, la fragilité des États voisins et l’effritement des alliances sécuritaires ; accroît la vulnérabilité du pays. L’absence d’une stratégie nationale proactive pour sécuriser les frontières, moderniser le renseignement et anticiper les menaces expose la Mauritanie à des infiltrations et à un risque croissant de perte de contrôle territorial. De plus, les campagnes médiatiques et les critiques internationales sur de supposées complaisances avec certains réseaux armés ou sur des atteintes aux droits humains ternissent l’image du pays, alors que les autorités répondent souvent par le silence ou le déni plutôt que par une diplomatie offensive et une communication transparente, ce qui renforce les soupçons et affaiblit la voix de la Mauritanie sur la scène internationale. Si ces défaillances persistent, leur cumul pourrait devenir explosif : la colère sociale et les fractures identitaires pourraient se rejoindre pour provoquer une crise politique majeure, tandis que les pressions extérieures pourraient isoler le pays ou justifier une ingérence diplomatique indirecte, et qu’un affaiblissement sécuritaire pourrait faire glisser la Mauritanie vers un scénario semblable à celui de certains voisins.
La Mauritanie traverse une phase critique où les fragilités du régime actuel s’entrecroisent avec les tensions internes, les bouleversements régionaux et les accusations extérieures croissantes. Si ces faiblesses ne sont pas corrigées rapidement, elles risquent de précipiter le pays dans une profonde instabilité. En dépit d’un discours officiel affichant des ambitions de réforme, le pouvoir peine à instaurer une véritable culture de transparence et de redevabilité : les nominations clientélistes, l’absence de sanction des abus et la faiblesse du contrôle parlementaire, d’une opposition crédible alimentent une méfiance généralisée qui affaiblit la crédibilité de l’État face à ses partenaires et réduit sa capacité à répondre aux critiques. Par ailleurs, la persistance de la pauvreté, l’insécurité urbaine grandissante, l’affluence continue des émigrés, le chômage massif des jeunes et l’injustice dans la répartition des ressources nourrissent un sentiment de marginalisation, tandis que le décalage entre les déclarations officielles et la réalité vécue par les citoyens mine la confiance envers les institutions et crée un terrain propice aux protestations ou à la radicalisation. Le régime n’a pas non plus su désamorcer les tensions ethniques et communautaires ni instaurer un dialogue politique inclusif, laissant les divisions internes se transformer en leviers d’instrumentalisation qui sapent la cohésion nationale et affaiblissent la résilience du pays face aux pressions extérieures. Dans le même temps, l’instabilité régionale au Sahel ; marquée par la progression des groupes armés, la fragilité des États voisins et l’effritement des alliances sécuritaires ; accroît la vulnérabilité du pays. L’absence d’une stratégie nationale proactive pour sécuriser les frontières, moderniser le renseignement et anticiper les menaces expose la Mauritanie à des infiltrations et à un risque croissant de perte de contrôle territorial. De plus, les campagnes médiatiques et les critiques internationales sur de supposées complaisances avec certains réseaux armés ou sur des atteintes aux droits humains ternissent l’image du pays, alors que les autorités répondent souvent par le silence ou le déni plutôt que par une diplomatie offensive et une communication transparente, ce qui renforce les soupçons et affaiblit la voix de la Mauritanie sur la scène internationale. Si ces défaillances persistent, leur cumul pourrait devenir explosif : la colère sociale et les fractures identitaires pourraient se rejoindre pour provoquer une crise politique majeure, tandis que les pressions extérieures pourraient isoler le pays ou justifier une ingérence diplomatique indirecte, et qu’un affaiblissement sécuritaire pourrait faire glisser la Mauritanie vers un scénario semblable à celui de certains voisins.
Face à ces menaces, un sursaut national s’impose : il faut adopter une gouvernance plus transparente, instaurer un dialogue politique sincère, renforcer une diplomatie active et mettre en place une stratégie sécuritaire robuste et intégrée. Seule une reconnaissance lucide des risques et une action courageuse permettront de préserver la stabilité du pays, de consolider son unité nationale et d’éviter un basculement vers l’inconnu dans une région sahélienne déjà en ébullition. Je reviendrai très bientôt avec plus de détails et des preuves précises qui suscitent une inquiétude grandissante et méritent d’être connus de tous.
Haroun Rabani
